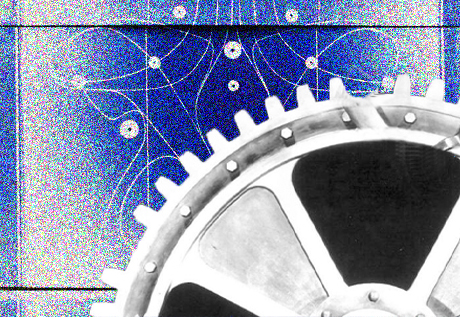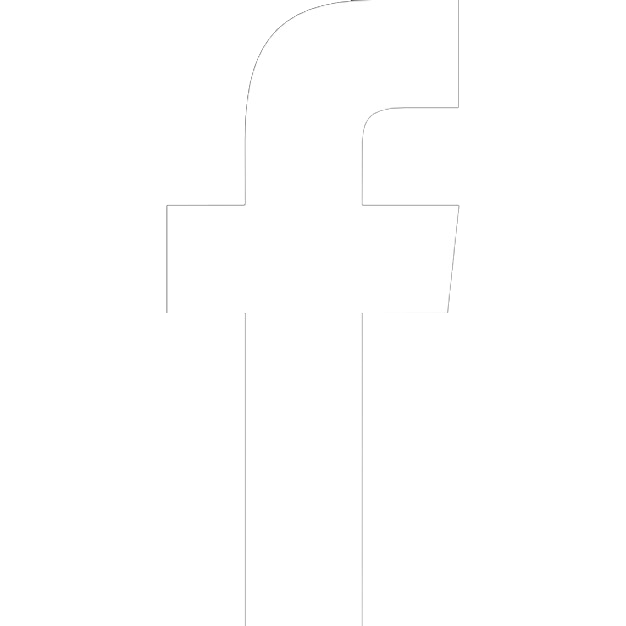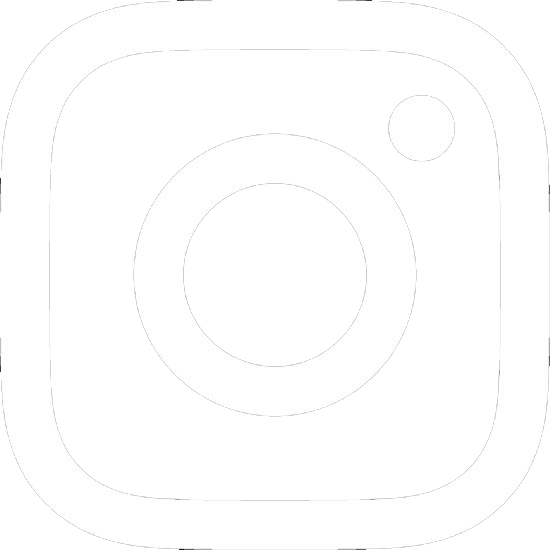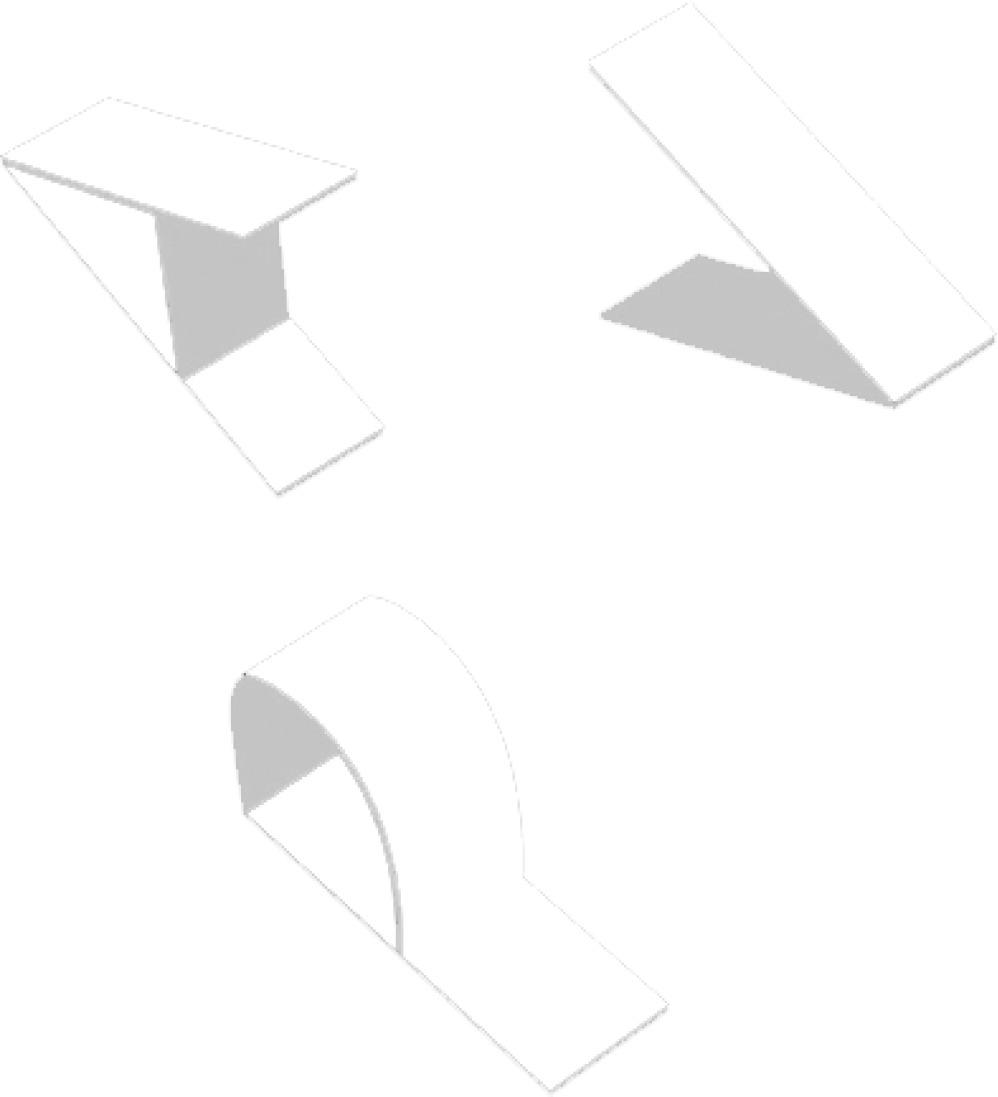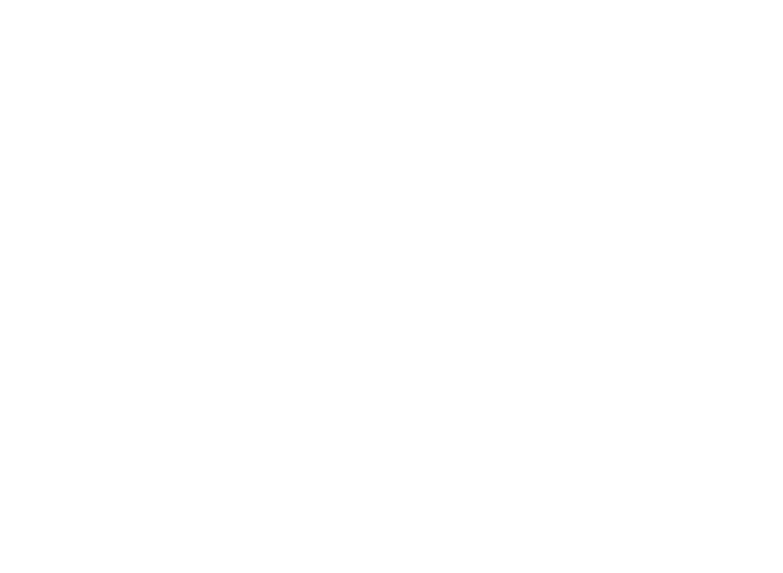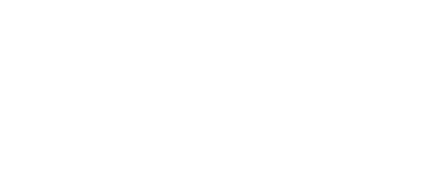Ce cycle de conférences essaye de montrer en quoi les avancées technologiques du 20e siècle ont modifié le rapport des artistes à la création, de la spécialisation des tâches à l’intelligence artificielle, jusqu’à rendre la machine autonome – la technologie pourrait-elle alors s’affranchir de l’être humain ?
L’art a tout à voir avec la technique. Les mots « technê » (en grec) et « ars » (en latin) signifient tous deux savoir-faire. Mais c’est au 18e siècle, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, que l’art s’en distingue radicalement. La différence tient à sa finalité : si l’art vise le Beau, la technique a pour but l’utilité. Plus encore, pour le philosophe Alain, ce qui sépare l’artiste de l’artisan, c’est la capacité de ce dernier à appliquer un plan et à pouvoir le reproduire, tandis que « l’idée » vient à l’artiste « à mesure qu’il fait » (Alain, Système des Beaux-Arts, 1920). Quand Auguste Rodin fait scandale avec L’Âge d’airain en 1877, ce n’est pas pour avoir demandé à son fondeur de l’exécuter en bronze, mais car il est soupçonné d’avoir moulé sa figure sur modèle vivant, c’est-à-dire d’avoir appliqué une technique de reproduction mécanique.
Il faut également distinguer la technique, qui renvoie aux compétences et aux méthodes utilisées pour effectuer une tâche (le silex taillé lors du Paléolithique, 2,5 millions d’années avant J.C.) et la technologie qui désigne l’étude scientifique et comparative des outils et des systèmes de production. C’est la technologie qui permet de mettre en relation deux techniques permettant, par exemple, à Henry Ford d’automatiser les tâches en introduisant la chaîne de montage en 1913.
La thématique de ce cycle prend appui sur la programmation du Grand Café pour la saison 2023-2024, avec l’exposition objectif : société (variations goldberg) d’Edgar Sarin puis avec les projets du premier trimestre 2024.
Calendrier :
Jeudi 19 octobre 2023 à 18h30
Conférence à Bain Public
Diviser le travail : une histoire de la création à plusieurs
Si l’image de l’artiste seul dans son atelier émerge au 19e siècle, la division technique du travail en art est pourtant la règle depuis l’Antiquité gréco-romaine. Le maître est secondé par des assistants qui préparent, voire participent à la création des œuvres. Quand Andy Warhol fait de son atelier une Factory (usine) à New York en 1964, il radicalise la fonction de l’artiste qui n’est pas là pour réfléchir, mais pour produire. « J’aimerais être une machine, pas vous ? », demande-t-il. Collaborer, répartir ou déléguer l’exécution des tâches sont des pratiques de plus en plus courantes au 20e siècle. László Moholy-Nagy commande ainsi 5 peintures à un fabricant d’enseignes par téléphone… en 1922. Mais alors où est l’œuvre ? qui est l’auteur ? le concepteur, le technicien ou l’outil lui-même ? Le récent procès opposant Daniel Druet et Maurizio Cattelan sur la paternité des sculptures prouve que la question n’est pas tranchée. Diviser le travail est-il toujours aliénant ou peut-il participer à de nouveaux modes de co-création, comme le proposent Marie Preston et François Dufeil ?
Jeudi 9 novembre 2023 à 18h30
Conférence à Bain Public
Reproduire : quand la technique interroge l’authenticité
En 1935, Walter Benjamin soutient que la reproductibilité de l’œuvre d’art entraîne la perte de son aura. Système de démocratisation, outil critique ou de propagande, la reproduction mécanique de la photographie et du cinéma va « plus vite que la main ne dessine ». Face à cette accélération sans limite sur laquelle repose l’économie mondialisée, une question se pose : peut-on tout reproduire à l’identique ? Quand Simon Starling permute l’aluminium d’une chaise et d’un vélo, l’illusion est parfaite, mais quand Pier Paolo Pasolini tente de faire rejouer des tableaux de maîtres par des figurants dans La Ricotta, la répétition se transforme en sketchs comiques… En détournant les moyens de production de masse, les artistes du photomontage John Heartfield, Alexandre Rodchenko ou Varvara Stepanova érigent la technique en instrument politique. Dans le sillage de Marcel Duchamp, l’artiste conceptuelle Sherrie Levine s’est réappropriée avec une finition parfaite le travail d’autres artistes, puis le sien grâce à la photographie argentique, puis la manipulation numérique. Elaine Sturtevant récupère un écran de sérigraphie usagé d’Andy Warhol pour répliquer ses Flowers… Reproduire, est-ce toujours usurper ?
Jeudi 14 décembre 2023 à 18h30
Conférence à Bain Public
Changer d’échelle : comment l’industrie permet de dépasser l’humain
Les innovations industrielles ont permis aux artistes du 20e siècle de changer l’échelle de leurs œuvres. Travailler « à grande échelle » signifie à la fois agrandir sa pièce, avec des moyens souvent spectaculaires, mais aussi penser un grand nombre d’objets, le multiple, la série. Pour parvenir à réaliser ses Stabiles en acier riveté dans les années 1960, Alexandre Calder fait appel à des chaudronniers reproduisant ses maquettes en format monumental, toujours sous son contrôle. Michael Heizer travaille avec des entreprises du BTP (bâtiment et travaux publics), mais aussi des ingénieurs, pour déplacer, excaver, construire des œuvres démesurées à la limite de l’architecture et dont le processus de fabrication participe de leur légende. La production collective de pièces multiples renvoie, quant à elle, davantage à la fabrication artisanale. La technique du moulage existe ainsi depuis l’Antiquité, mais quelle différence entre les bronzes d’Auguste Rodin, limités à 12 exemplaires par le marché pour être considérés comme des « originaux », et la lampe de chevet en métal de Marianne Brandt et d’Hans Przyrembel produite à 50 000 exemplaire entre 1928 et 1932 ?
Jeudi 15 février 2024 à 18h30
Conférence à Bain Public
Redéfinir le rôle de l’humain face à la machine
Aujourd’hui, les logiciels d’intelligence artificielle semblent avoir dépassé les capacités humaines jusqu’à s’autonomiser de leurs concepteurs. On peut recréer des œuvres, à la fois plus vite et de meilleure qualité que l’originale, comme Julian Van Dieken l’a fait avec sa version hyperréaliste de La Jeune fille à la perle de Vermeer. Alors quelle est notre valeur ajoutée ? Comment redéfinir notre rôle face à la machine ? L’enchantement et le désenchantement pour la machine est symptomatique de l’entre-deux-guerres – Charlot emporté par les engrenages de la chaîne de montage dans Les Temps modernes en constitue l’image la plus frappante. En 2018, une œuvre de Banksy s’auto-détruit durant une vente aux enchères. Avant lui, en 1960, Jean Tinguely inaugure la première sculpture autodestructrice de l’histoire. Si Anne-Valérie Gasc et New Territories construisent des ruines à l’aide de la robotique, Roy Köhnke et Justine Emard tentent de reconnecter l’humain aux nouvelles technologies. Une tentative de réparation ? Ritualiser, communiquer, sentir, et peut-être même danser.
Intervenant pour les quatre premières conférences :
Ilan Michel est critique d’art et commissaire d’exposition indépendant, il s’intéresse aux relations entre l’art contemporain et les avant-gardes artistiques du début du 20e siècle. De 2016 à 2021, il a été assistant aux expositions au Frac Centre-Val de Loire et assistant scientifique d’expositions au Musée des beaux- arts et d’archéologie de Besançon. Il est actuellement chargé de médiation au Musée d’arts de Nantes. Il écrit pour les revues 02, La Belle Revue, Critique d’art.
Informations pratiques :
Les conférences ont lieu à Bain Public : 24 rue des Halles, Saint-Nazaire
Entrée 6 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeur·es d’emploi inscrit·es à Pôle emploi, les bénéficiaires du RSA et les élèves de l’École des Beaux-arts Nantes – Saint-Nazaire (sur présentation de justificatifs).
Sur réservation au 02 51 76 67 01 ou par mail : publicsgrandcafe@saintnazaire.fr
_ _ _
La thématique de la suite de ce cycle prend appui sur la programmation du Grand Café pour la saison 2023-2024, avec l’exposition : Power Up Imaginaires techniques et utopies sociales.
Mardi 20 février 2024 à 18h30
Conférence à Bain Public
Futurs énergétiques de l’estuaire de la Loire (1945-2000)
Rencontre avec Anaël Marrec en dialogue avec Michel Mahé autour de l’histoire de l’architecture et des aménagements techniques de la Loire.
Anaël Marrec est historienne des techniques à l’époque contemporaine, chercheuse postdoctorale à l’Université de Nantes. Avec une démarche d’histoire environnementale, elle examine les énergies renouvelables et nucléaire en tant que solutions technologiques, en analysant leurs promoteurs, leurs détracteurs et leurs impacts environnementaux. Dans le cadre du projet ANR Estuer, elle examine les transformations de l’estuaire de la Loire comme espace énergétique après la seconde guerre mondiale. Objet d’imaginaires productifs, de conflits sociaux et de transformations écosystémiques, l’estuaire devient un acteur mouvant, riche et fragile de l’histoire énergétique ligérienne.
Michel Mahé est historien et président de l’association nazairienne Aremors.
Informations pratiques :
Rendez-vous à Bain Public : 24 rue des Halles, Saint-Nazaire
Gratuit, sur réservation au 02 51 76 67 01 ou par mail : publicsgrandcafe@saintnazaire.fr
_ _ _
Jeudi 7 mars 2024 à 18h30
au Grand Café puis à l’Hôtel de Ville
Une heure, une œuvre “Le maître des fils”
Jean Picart Le Doux, tapisseries d’Aubusson, un patrimoine mondial UNESCO à Saint-Nazaire
Un rendez-vous patrimoine & création contemporaine par la Mission des Patrimoines, Ville de Saint-Nazaire.
Avec plus de 400 tapisseries originales produites de son vivant, Jean Picart Le Doux est considéré comme un Grand maître de la tapisserie d’Aubusson. Il a le souci d’une tapisserie décorative élaborée à partir d’une composition classique et exploitant au maximum les multiples possibilités offertes par la teinture des laines. Les couleurs sont pour lui à la fois des ornements et le moyen de faire éclater les oppositions : le jour et la nuit, le ciel et la terre, l’ombre et la lumière. À Aubusson, l’atelier Berthaut tisse ses principaux modèles. Le rdv vous propose de partager l’histoire de cet exceptionnel centre mondial.
L’exposition du Grand Café propose et met en perspective une tapisserie, collection de la Ville d’Angers. Après la découverte de cette œuvre nous gagnerons l’hôtel de ville pour la découverte de la salle des mariages dont les tapisseries ont été récemment acquises. A titre exceptionnel, le bureau du maire qui recèle une pièce unique de l’histoire de la ville : la tapisserie réalisée en 1960 pour célébrer la renaissance de Saint-Nazaire, sera accessible.
La tapisserie d’Aubusson est inscrite depuis 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, UNESCO.
Informations pratiques :
Rendez-vous au Grand Café puis à l’hôtel de ville, rdv au centre d’art pour le début de la rencontre.
Gratuit, sur réservation au 02 51 76 67 01 ou par mail : publicsgrandcafe@saintnazaire.fr
_ _ _
Jeudi 13 juin (date initiale mardi 9 avril) 2024 à 18h30
à Bain Public, 24 rue des Halles
Les relations entre architecture, décolonisation et pratiques écologiques dans la France d’après-guerre.
Rencontre avec Paul Bouet en dialogue avec Maya Mihindou.
Paul Bouet est historien de l’architecture et de l’environnement et maître de conférences en histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Est, Université Gustave Eiffel
Maya Mihindou est artiste illustratrice photographe et journaliste. Elle vit et travaille à Marseille. Autodidacte, elle se forme à l’image par le biais de l’illustration, ce qui l’amène à découvrir le monde de l’édition et de l’impression. Le dessin lui permet d’aborder la question des mémoires précaires, déracinées, fragiles et mouvantes. L’un de ses matériaux principaux sont les archives et le recueil de témoignage. Elle contribue, depuis 2014, à l’écriture d’articles et à la réalisation de portraits, reportages et entretiens pour les revues Ballast, Mille Cosmos, Panthère Première et The Funambulist. Elle documente également le travail d’autres artistes, en photographie comme en vidéo. Depuis 2007, elle gère une structure de microédition nommée Vertébrale.
Informations pratiques :
Mardi 9 avril à 18h30 à Bain Public : 24 rue des Halles
Durée environ 1h30, gratuit, sur réservation au 02 51 76 67 01 ou par mail : publicsgrandcafe@saintnazaire.fr