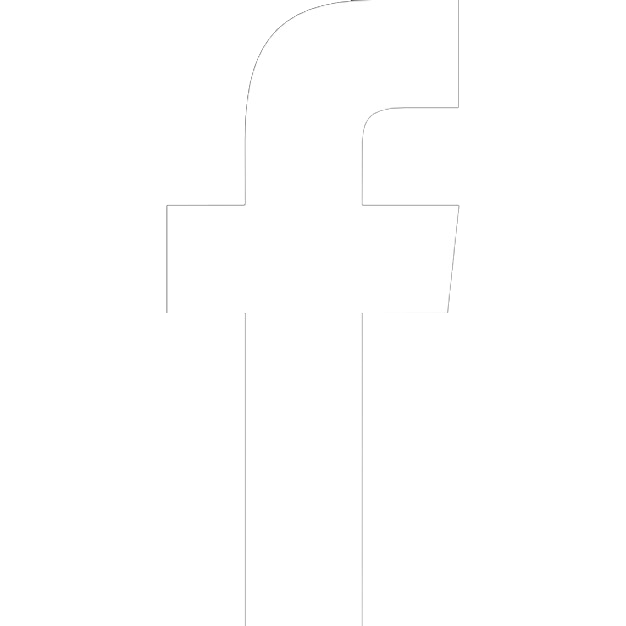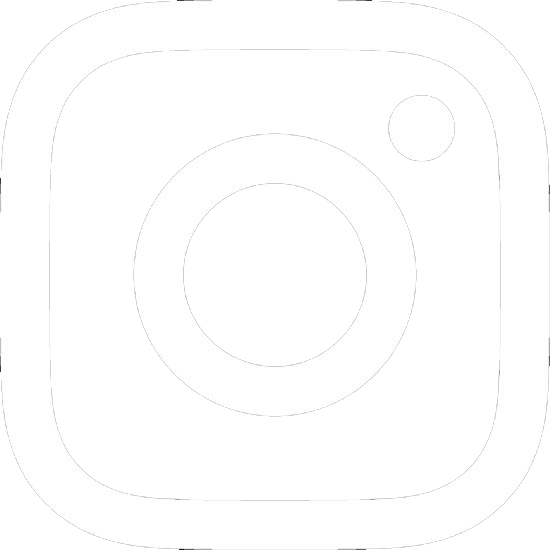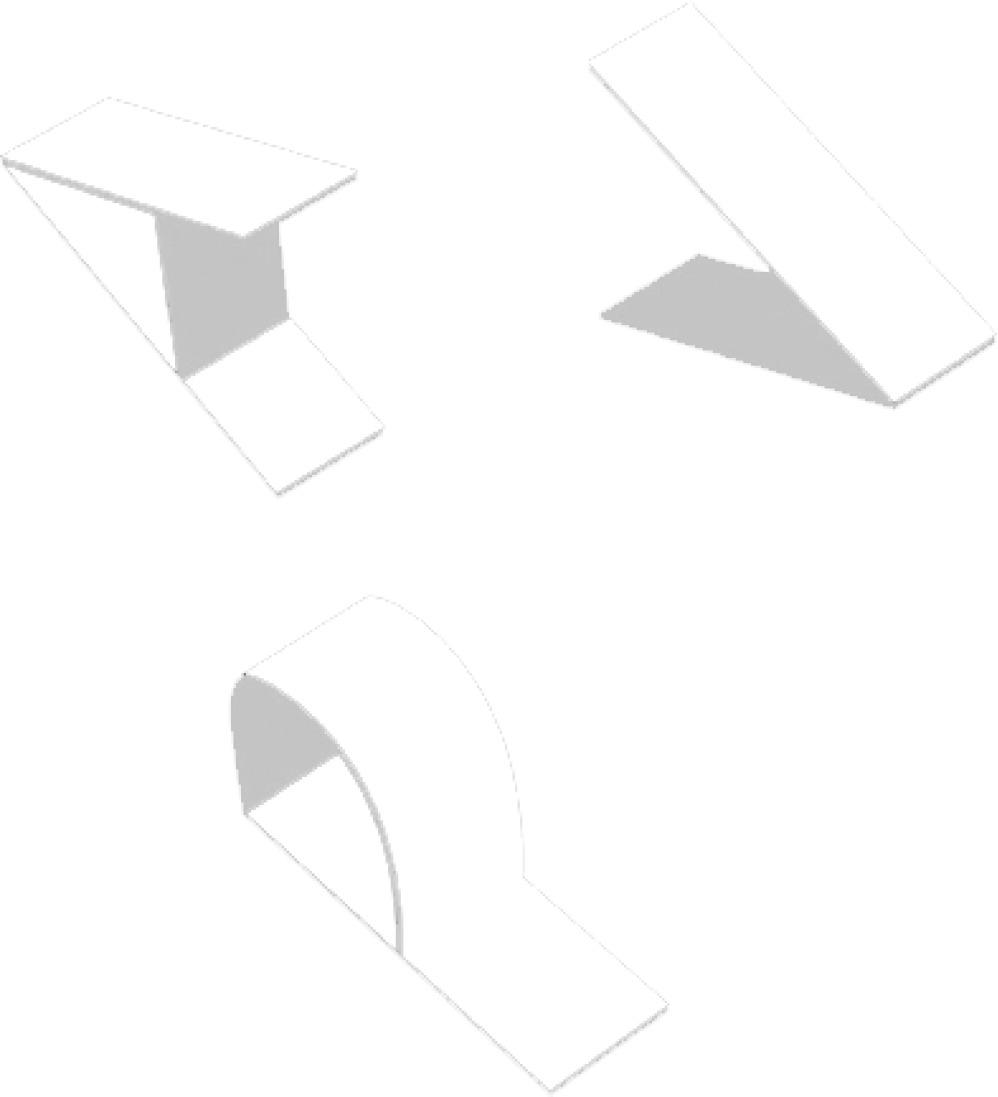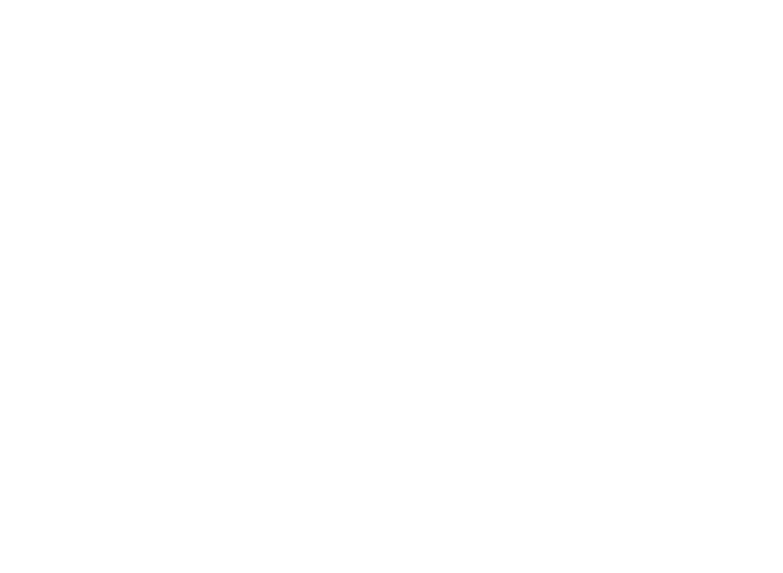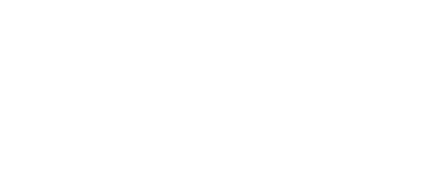Étonnamment, la question de l’intimité a émergé très tardivement en histoire. Ce n’est qu’en 1987, avec la publication de L’Histoire de la vie privée sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, que la notion a servi à qualifier la séparation entre vie publique et vie privée dans les milieux bourgeois au 19e siècle, en accordant à cet espace une portée politique.
L’art est le mode d’expression privilégié de l’intime, un cadre propice à sa mise en scène. La peinture et la littérature ont été ses principaux espaces de représentation.
Avec ses Confessions (1782), qui marquent la naissance de l’autobiographie, Jean-Jacques Rousseau avoue que la sincérité n’échappe pas à la mise en scène de soi… prémices de l’autofiction. Et en 1969, le psychanalyste Jacques Lacan introduit la notion d’« extimité » : que décide-t-on d’exposer au grand jour ? À l’ère des réseaux sociaux et des écrans connectés, cette frontière entre le privé et le public tend à se dissoudre : exhibition, narcissisme… Si l’on sait depuis Michel Foucault que l’intime est politique, il devient essentiel de définir où il se loge aujourd’hui.
Les conférences sont menées par Ilan Michel, critique d’art.
Calendrier :
Jeudi 16 octobre à 18h30 : Une chambre à soi
Jeudi 6 novembre à 18h30 : Jeu de miroirs : voir et être vu·e
Jeudi 4 décembre à 18h30 : Intense proximité
Jeudi 15 janvier à 18h30 : Dans la peau
Jeudi 12 février à 18h30 : Dévoiler la maladie
Jeudi 12 mars à 18h30 : Réseaux sociaux, exhibition et surveillance
Conférencier :
Ilan Michel est critique d’art et commissaire d’exposition indépendant, il s’intéresse aux relations entre l’art contemporain et les avant-gardes artistiques du début du XXème siècle. De 2016 à 2021, il a été assistant aux expositions au Frac Centre-Val de Loire et assistant scientifique d’expositions au Musée des beaux- arts et d’archéologie de Besançon. Il est actuellement chargé de médiation au Musée d’arts de Nantes. Il écrit pour les revues 02, La Belle Revue, Critique d’art.
Informations pratiques :
Les conférences ont lieu à l’Amphithéâtre de l’EPF : 5 place Germaine Tillion (à côté de l’École des Beaux-Arts), Saint-Nazaire
Entrée 6 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeur·es d’emploi inscrit·es à France Travail, les bénéficiaires du RSA et les élèves de l’École des Beaux-arts Nantes – Saint-Nazaire et de l’EPF (sur présentation de justificatifs).
Sur réservation au 02 51 76 67 01 ou par mail : publicsgrandcafe@saintnazaire.fr
Programmation détaillée :
Jeudi 16 octobre 2025 à 18h30
Une chambre à soi
Ce cycle de conférences s’ouvre sur un espace fondateur de l’intimité : la chambre. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis le 19ᵉ siècle, lieu privilégié de la vie de couple, la chambre reflète les enjeux de l’idéal bourgeois. Y introduire des inconnu·es ou la transformer en terrain de jeu (Nicola L., Sophie Calle) sont autant de stratégies pour faire éclater le modèle conjugal. Peu à peu, la chambre devient un espace de vérité : elle raconte le désir et la dépendance sexuelle (Nan Goldin), mais aussi la perte (Felix Gonzalez-Torres). Si la chambre dit parfois la violence, elle représente l’espace même de la pensée, du rêve, du souvenir et ouvre à la fiction (Jean-Jacques Rullier, Dominique Gonzalez-Foerster).
Jeudi 6 novembre 2025 à 18h30
Jeu de miroirs : voir et être vu·e
Au 19e siècle, les grandes psychés meublent les chambres bourgeoises. Peu à peu, le miroir se démocratise et permet l’accès à l’image de soi. Support d’introspection, l’accessoire est aussi un moyen de se conformer aux normes de beauté (Chantal Akerman, Marina Abramović). Le miroir devient au 20e siècle un outil de redécouverte de soi et de son intimité. En 1936, le psychanalyste Jacques Lacan met en lumière le rôle du miroir dans la formation du « Je ». Dans les autoportraits de l’artiste surréaliste Claude Cahun, le miroir ne révèle pas une vérité sur soi, mais relève de la mise en scène. Plus récemment, en 2005 au Grand Café, Leandro Erlich invite les visiteur·euses à se confronter à un dispositif troublant, où chacun·e devient tour à tour patient·e et psychanalyste.
Jeudi 4 décembre 2025 à 18h30
Intense proximité
À partir de quand franchit-on la limite de l’espace vital de l’autre ? La « proxémie », notion forgée par l’anthropologue Edward T. Hall en 1963, met en lumière les normes invisibles qui structurent nos relations sociales. Yoko Ono invite le public à découper un morceau de ses vêtements. Ulay et Marina Abramović se tiennent nus dans l’embrasure d’une porte de galerie à Bologne : pour entrer, le ou la visiteur·euse doit franchir le seuil formé par leurs corps. À l’inverse, la filature implique de maintenir une distance précise : assez proche pour ne pas perdre la trace, mais suffisamment éloignée pour ne pas être découvert·e. Chez Sophie Calle, cette pratique devient un prétexte à l’autofiction.
Jeudi 15 janvier 2026 à 18h30
Dans la peau
La peau a longtemps été pensée comme une frontière. Le philosophe Merleau-Ponty a démontré, à travers la sensation du toucher, qu’elle jouait le rôle d’interface. Acte de tendresse quand un baiser y est déposé (Barbara T. Smith), ou de réparation quand Marie-Ange Guilleminot offre ses mains aux passant·es de Tel-Aviv peu après un attentat à la bombe, toucher l’autre n’est jamais neutre. Alors que Dennis Oppenheim dessine sur le dos de son fils qui le retranscrit au mur, il croit entrer en contact avec son propre passé. Sentir la peau invite à reconnaître sa porosité, comme la vibration du pouls révèle les battements du cœur. Cependant, ouvrir la peau est tabou. Les organes en tissu d’Annette Messager, les paysages de chairs de Carole Mousset et la caméra endoscopique de Mona Hatoum nous font pénétrer à l’intérieur des corps comme dans une forêt interdite.
Jeudi 12 février 2026 à 18h30
Dévoiler la maladie
L’essayiste Susan Sontag écrivait en 1978 que l’expérience intime de la maladie nous rappelle brutalement que nous ne sommes qu’un corps. Qu’est-ce qui provoque ce malaise face aux poses de pin-up adoptées par Hannah Wilke, affaiblie par le cancer ? Face à la sidération, la chorégraphe Anna Halprin choisit de se réapproprier son corps et collabore avec des personnes atteintes de cancer ou du sida. Proche de la chorégraphe californienne, Alain Buffard, qui a participé à ses ateliers de danse-thérapie, reconstruit un corps hors norme, enrichi de prothèses. Aujourd’hui, Sabrina Röthlisberger transforme le crochet en un acte de résilience tandis que Benoît Piéron questionne l’idée de normalité et tente de forger des discours alternatifs sur la maladie.
Jeudi 12 mars 2026 à 18h30
Réseaux sociaux, exhibition et surveillance
La téléréalité et les réseaux sociaux ont redéfini les limites entre sphère publique et vie privée. Émilie Brout & Maxime Marion explorent cette porosité à travers une autofiction où ils se mettent en scène en tant que couple dans un quotidien idéalisé et « instagrammable ». La culture numérique transforme nos vies en spectacle permanent. En 2012, Ai Weiwei installe des caméras chez lui à Pékin, prenant le contre-pied de la surveillance dont il est victime. Si Internet se présente comme un espace de liberté, quelles traces laissons-nous à notre insu ? L’ADN constitue l’information biologique la plus intime que nous possédions. Pourtant, beaucoup n’hésitent pas à envoyer des échantillons pour des recherches généalogiques… Un matériau que la biohackeuse Heather Dewey-Hagborg utilise pour reconstituer les portraits-robots des donneur·euses.